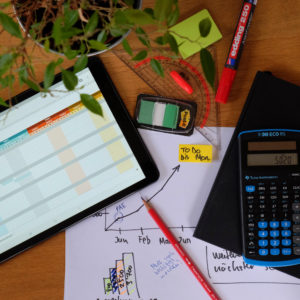Jours fériés d’avril et mai 2018

Jours fériés travaillés ou non ?
Parmi les jours fériés légaux, seul le 1er mai est obligatoirement non travaillé pour tous les salariés. Les autres jours fériés légaux ordinaires sont chômés si :
– un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou accord de branche le prévoit ;
– en l’absence de convention ou d’accord collectif, une décision de l’employeur le prévoit.
Par exception, le travail le 1er mai ne peut avoir lieu que dans les secteurs qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics…) (C. trav., art. L. 3133-6).
Pas de récupération du jour férié chômé. Le salarié n’a pas à récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié chômé. Il ne peut pas prétendre à un jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé, sauf si des dispositions conventionnelles plus favorables le prévoient.
Jours fériés obligatoirement chômés. Les salariés âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours fériés légaux, sauf dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient (hôtellerie, restauration, spectacles, etc.). En Alsace-Moselle, les jours fériés sont chômés, sauf dérogations.
Paiement des jours fériés
Pour les jours fériés légaux ordinaires non travaillés, le salarié mensualisé est rémunéré intégralement s’il justifie d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (maintien du salaire) (C.trav., art. L.3133-3-2).
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois.
En revanche, les salariés qui ne justifient pas d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ne bénéficient pas de ce maintien de salaire pour les jours fériés chômés, sauf usage ou dispositions conventionnelles plus favorables.
Si le jour férié légal ordinaire est travaillé, le salarié perçoit une rémunération normale, sauf si une convention collective ou un usage prévoit des conditions de rémunération plus avantageuses (ex. : prime, taux horaire majoré).
Cas du 1er mai. Le salarié qui ne travaille pas le 1er mai est obligatoirement payé. Cette journée ne peut pas entraîner de réduction de salaire. Les heures supplémentaires habituellement effectuées doivent être payées avec majoration de salaire. Ce maintien de salaire n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.
Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie d’une rémunération exceptionnelle (c. trav. art. L. 3133-6). L’employeur doit leur verser, en plus de son salaire habituel, une indemnité d’un montant égal à ce salaire habituel. Le travail du 1er mai est donc majoré à 100 %. Ni l’employeur ni un accord collectif ne peuvent décider d’une compensation différente.
Et si la convention collective ou l’accord collectif applicable dans l’entreprise prévoit l’attribution d’un jour de repos compensateur en cas de travail le 1er mai, ce jour de repos constitue un avantage supplémentaire, qui doit s’ajouter à l’indemnité légale et non la remplacer. Le montant de l’indemnité spéciale versée au titre du travail du 1er mai doit apparaître distinctement sur le bulletin de salaire.
Les ponts : comment sont-ils fixés ?
Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise. En mai 2018, plusieurs journées de pont sont possibles les lundis 30 avril et 7 mai et le vendredi 11 mai.
La pratique des ponts ne fait l’objet d’aucune réglementation. La décision est prise au niveau de l’entreprise ou de chaque établissement par une décision de l’employeur. La journée de pont constitue une modification temporaire de l’horaire hebdomadaire. Elle est soumise à consultation des représentants du personnel. L’horaire modifié doit être affiché et une copie de cet horaire est transmise à l’inspecteur du travail.
La récupération des heures chômées du fait d’un pont. Les heures de travail perdues en raison d’une interruption collective du travail due au chômage de 1 ou de 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (pont) ou d’un jour précédant les congés annuels peuvent être récupérées (c. trav. art. L. 3121-50).
L’inspecteur du travail est préalablement informé par l’employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération.
Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, à une convention ou un accord de branche de peuvent fixer les modalités de récupération des heures perdues en raison d’un pont. À défaut d’accord collectif :
– les heures perdues ne sont récupérables que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte ;
– les heures de récupération ne peuvent être réparties sur toute l’année mais ne peuvent pas augmenter la durée du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.
Les heures de récupération d’un pont sont des heures normales de travail dont l’exécution a été différée : elles sont donc payées au salaire habituel, sans majoration. Le salarié ne peut pas réclamer une rémunération supplémentaire pour les heures de récupération d’un pont, sauf si les heures perdues ont été déduites du salaire versé pour le mois où le pont a été organisé.
Sources : c. trav. art. L.3133-1 et suivants
© Copyright Editions Francis Lefebvre